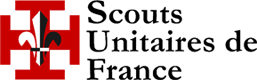19/09/2024 - Plus engagés, plus écolos, plus heureux, l'utilité sociale du scoutisme
Une enquête de l'IFOP révèle qu'en moyenne les adultes qui ont fait du scoutisme sont plus engagés dans la vie civique, mais aussi plus éveillés aux enjeux environnementaux et en meilleure santé mentale.Résumant en quelques mots l’intuition qui l’avait conduit à imaginer les premiers camps scouts, avant de donner naissance au vaste mouvement d’éducation qu’est devenu le scoutisme, Robert Baden-Powell aimait parler de « civisme à l’école de la nature et des bois ». Au soir de sa vie, dans son Dernier message aux scouts, l’officier britannique exhortait encore ainsi les centaines de milliers de jeunes qui ont depuis répondu à son appel : « Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée. » Une façon pour le fondateur du scoutisme de rappeler que l’on n’est pas seulement « boy-scout » au fond de la forêt… À sa suite, loin de se cantonner à un stage de bushcraft dans les ronces, les associations de scoutisme en France entendent réaffirmer « l’utilité sociale du scoutisme » en montrant aujourd’hui combien les années de scoutisme prédisposent les futurs adultes à l’engagement citoyen.
Pour mesurer cet impact de l’aventure scoute sur l’ensemble de la vie civique, une enquête de l’Ifop pour le Rasso (un réseau d’anciens passés par les Guides et Scouts d’Europe) montre que les anciens scouts sont largement plus engagés dans la société que la moyenne des autres Français. Cette étude, qui compare les réponses apportées par d’anciens membres des principales associations de scoutisme en France et celles données par un échantillon représentatif de la société française, est sans appel : si un tiers environ (33 %) des Français participent aux activités d’une structure associative (club de sport, association caritative, culturelle, militante, syndicale, politique…), cette proportion s’élève à 87 % des anciens scouts.
Dans le détail, 32 % des anciens scouts sont membres d’une association sportive, contre 18 % de la population générale, et 31 % adhèrent à une association caritative, contre seulement 9 % sur l’ensemble des Français. L’écart est significatif également pour les associations culturelles, troupes de théâtre, ensembles musicaux… : 26 % des anciens scouts en font partie, contre 7 % de l’ensemble de la population. À rebours en revanche de certaines images d’Épinal, les anciens scouts ne sont pas plus engagés que la moyenne (3 %) dans la réserve militaire. « On constate un engagement associatif beaucoup plus fort, mais aussi une attitude altruiste et philanthrope nettement plus développée chez les anciens scouts que dans le grand public », commente Jérôme Fourquet, directeur du département opinions et stratégies d’entreprise de l’Ifop, ajoutant : « Le fait d’avoir été scout transcende les clivages ou les fractures traditionnelles, et le scoutisme inocule un virus civique qui reste très actif même quand on a quitté le mouvement et ce quel que soit le milieu social dans lequel on évolue. »
Ce « virus civique » s’observe encore à la fréquence à laquelle les anciens scouts participent à des activités bénévoles : parmi ceux qui indiquent participer à ces activités, 70 % des anciens scouts indiquent le faire « régulièrement », contre seulement 21 % de l’ensemble de la population. Les anciens scouts sont également un peu plus nombreux à occuper des responsabilités au sein des associations dont ils sont membres (44 %, contre 39 % pour l’ensemble).
Enfin l’attention aux autres passe également par des dons altruistes : 78 % des scouts déclarent donner chaque année à des associations, contre 44 % du grand public ; et 59 % donnent à des personnes dans le besoin, contre 34 % en moyenne dans l’ensemble de la population. Le montant moyen de ces dons est lui-même plus élevé : chez ceux qui déclarent donner, les anciens scouts donnent en moyenne 901 euros, contre 269 euros chez l’ensemble des Français. Conséquence d’une sociologie plus élitaire, avec des anciens scouts appartenant davantage aux classes aisées ? Pas seulement, car l’étude montre que les anciens scouts donnent plus, en moyenne, que l’ensemble des Français, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Ainsi, chez les catégories supérieures, le montant moyen des dons est près de trois fois supérieur chez les anciens scouts.
Autre indice du rôle que joue le scoutisme dans le développement (ou la confirmation) d’un véritable sens civique : la participation électorale. Celle-ci est supérieure de 10 à 20 points pour chaque élection, chez les anciens scouts : ainsi 95 % déclarent avoir fait le déplacement au bureau de vote pour l’élection présidentielle de 2022, quand la participation électorale était de 73,7 % au premier tour et de 72 % au second. Pour les élections législatives de 2022, où l’on enregistrait plus de 50 % d’abstention pour chacun des deux tours, 92 % des anciens scouts ayant répondu à l’enquête déclarent avoir glissé un bulletin dans l’urne.
Cette étude montre ainsi « que le scoutisme va bien au-delà d’une expérience de jeunesse, c’est une véritable école de la vie qui bénéficie à l’ensemble de la société et qui propose une réponse à bon nombre des problématiques sociétales auxquelles nous sommes collectivement confrontés », commente le président des Guides et Scouts d’Europe, Rémi Fourneraut.
Il faut dire que l’expérience scoute est elle-même ponctuée d’engagements personnels, au cours desquels les jeunes garçons et filles sont appelés à se consacrer au secours des autres : « Le scout est fait pour servir et sauver son prochain », énonce ainsi la loi scoute, transcrite par le père Sevin, un jésuite ami de Robert Baden-Powell d’après les textes du fondateur du scoutisme. « C’est en repensant à cette parole que j’avais entendue pendant mes années à la troupe que j’ai décidé de devenir sapeur-pompier volontaire », raconte ainsi Baptiste, 19 ans, engagé au SDIS du Val-d’Oise depuis un an et demi. Le jeune homme dit avoir « appris à aimer la vie en groupe, la discipline et le souci des autres » au cours de son expérience scoute. « Puis, quand un ami m’a parlé des pompiers volontaires, ça m’a paru logique avec ce que j’avais reçu et entendu. » Au terme de sa formation de secourisme et de lutte contre les incendies, il raconte encore avoir découvert « que les pompiers sont surtout appelés par des personnes seules, qui n’ont pas vraiment besoin de secours, mais juste d’aide, par exemple des personnes âgées qui ne savent plus comment changer les piles de leur lampe et qui nous appellent parce qu’elles sont dans le noir sans personne pour les aider ». Une expérience, parmi d’autres, de la conversion de l’engagement scout vers un engagement civique tourné cette fois vers la vie de la cité.
Si le scoutisme n’a donc pas seulement partie liée avec les clairières et les taillis et prédispose les jeunes garçons et filles à s’engager dans la cité, l’expérience du camp dans les bois n’est pas anodine pour autant : le scoutisme agit aussi comme un catalyseur de la préoccupation environnementale. 82 % des anciens scouts disent se sentir préoccupés par les conséquences du réchauffement climatique, soit 5 points de plus que dans l’ensemble de la population. Et, chacune à leur façon, les associations de scoutisme entendent renforcer dans leur pédagogie l’éveil à ces questions. À l’instar des Guides et Scouts d’Europe, qui ont choisi l’écologie comme axe d’effort pour l’année, les Scouts et Guides de France proposent à des centaines de jeunes des camps spécifiquement dédiés à l’action environnementale. Ainsi cet été, un grand rassemblement dans le golfe du Morbihan a rassemblé des jeunes gens désireux d’œuvrer à la protection des espaces naturels en ramassant les déchets sur le littoral et en sensibilisant les promeneurs. Pendant ce temps, dans la Drôme, un autre camp proposait avec l’aide de pères ingénieurs, de fabriquer des fours solaires : dans un nombre croissant de lieux de camp d’été, en effet, les décisions préfectorales interdisent l’usage des traditionnels feux de camp, compte tenu des sécheresses estivales. En lieu et place des braises, les jeunes gens ont donc fait cuire leurs repas à l’aide d’un concentrateur solaire. Depuis vingt ans, les Scouts et Guides de France ont d’ailleurs pris l’habitude d’épauler les marins-pompiers de Marseille en participant à la surveillance incendie dans les calanques. Ces camps « nature et environnement » se sont même développés jusqu’en Alsace.
« On a aussi toute une réflexion sur la low tech » expose Alexis Chaufrein, chargé de communication de l’association. « L’idée, c’est d’encourager la débrouillardise des jeunes, leur apprendre à réparer, leur permettre de comprendre des technologies simples et sobres .» Une intuition qui vise juste, semble-t-il : d’après l’Ifop, les anciens scouts ont également un rapport plus parcimonieux aux écrans : seuls 59 % d’entre eux déclarent passer plus de deux heures chaque jour sur un écran en dehors du temps de travail, contre 70 % de l’ensemble des Français. Et sans surprise, 78 % des scouts disent passer du temps « dans la nature », pour randonner, jardiner ou faire des activités de plein air, contre à peine plus de la moitié des Français.
L’enquête, enfin, conforte les guides et scouts quant à l’importance de la vie au grand air et du souci du commun pour le bien-être et l’épanouissement de la personne humaine. Dans un exercice qui consiste à évaluer son « niveau de bien-être » sur une échelle de 0 à 10, l’auto-évaluation moyenne des anciens scouts culmine à 7,9, contre 6,3 sur l’ensemble de la population. « Nous croyons que la vie dans la nature, le vivre ensemble et l’action citoyenne sont des vecteurs de joie et d’épanouissement », commente Hervé Pralong, responsable national du réseau Impeesa, qui rassemble les anciens des Scouts et Guides de France. « Le scoutisme est aussi une école de la connaissance de soi, ajoute Agathe Lizé, responsable chez les Scouts unitaires de France. On se détache des apparences pour apprendre à se connaître en profondeur en cultivant ses talents, ce qui permet de se sentir utile et à sa place dans le monde. »
Un esprit sain dans un corps sain… et dans une société saine : « Le scoutisme contribue à forger des individus et des citoyens équilibrés et bien dans leur peau, qui s’en sortent psychologiquement mieux que le reste de la population. C’est un point positif pour la société que de pouvoir compter sur des citoyens bien dans leur tête », conclut Jérôme Fourquet.